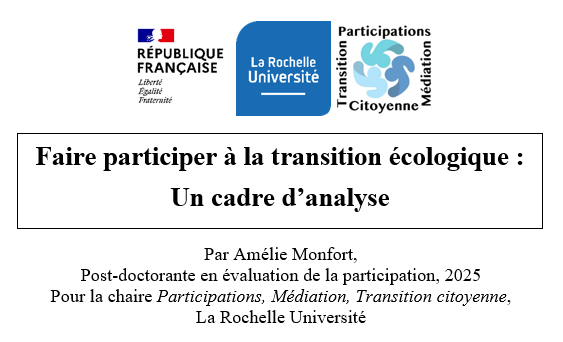
Published in:
Rapports de recherche
Faire participer à la transition écologique: un cadre d’analyse
Ce rapport propose un cadre d’analyse synthétique des processus participatifs mis en œuvre dans les démarches de transitions écologiques, leur design et le rôle du citoyen en leur sein.
Par Amélie Monfort, chercheure postdoctorale pour la Chaire Participations Médiation Transition citoyenne.
Objectifs du rapport
Dans le cadre de son travail, Amélie Monfort s’est intéressée aux différents processus et dispositifs participatifs mobilisés dans le cadre des transitions écologiques. Face à la multiplication des démarches qualifiées de « participatives », souvent hétérogènes et difficilement comparables, son rapport offre un cadre d’analyse pour mieux appréhender leurs logiques de conception et de déploiement, ainsi que les formes d’écocitoyenneté qu’elles contribuent à encourager. Elle s’est particulièrement intéressée à deux dimensions de ces processus:
le design participatif: pourquoi, comment et pour quels publics le processus est-il pensé?
le rôle du citoyen au sein de ces dispositifs et processus.



